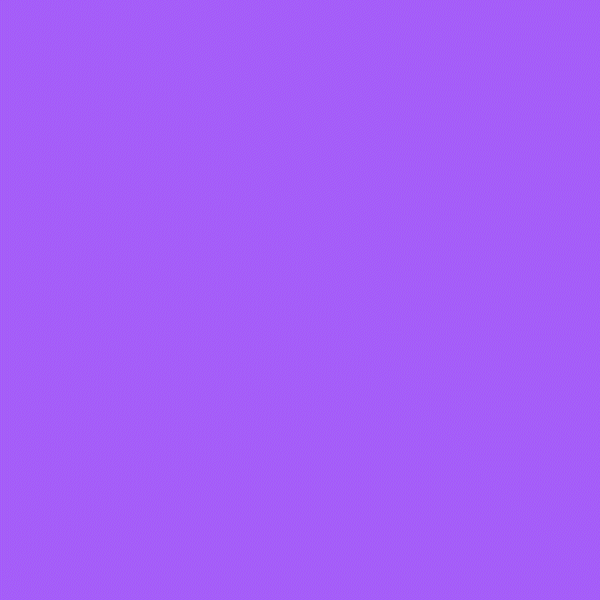
SYMPOÏÉTIQUE
ARTS DE FAIRE DE LA VILLE ÉCOLOGIQUE
Du 28.02 au 15.05.23
Archizoom, SG building, EPFL
La culture écologique occupe une place grandissante dans la conception de la ville actuelle. Elle constitue le pivot à partir duquel il est possible d’énoncer de nouvelles manières de regarder, de procéder et d’opérer, fabriquant un ensemble d’arts de faire dans et pour la ville écologique.
Commissariat
Archizoom & UR, bureau d’architecture et urbanisme.

Maquette produite par UR, Peaks, Altitude 35 – avec les contributions de ZEFCO, Marie Cazaban-Mazerolles et Julien Claparède-Petitpierre et les photographies d’Antoine Espinasseau pour l’exposition Augures, commissionnée par Djamel Klouche, BAP! 2019
Vernissage lundi 27 février, 18h00, fr
Conférence d’ouverture
Gaétan Brunet & Chloé Valadié (UR)
Visite guidée lundi 27 mars, 17h00, fr
par les commissaires, sur inscription
Dialogue lundi 27 mars, 18h30, fr
Culture écologique * culture du projet
Pierre Charbonnier & Djamel Klouche (l’AUC)
Dialogue lundi 17 avril, 18h30,
Forme, langage, relation
Sophie Dars (Accattone) & Sébastien Martinez-Barat (MBL architectes)
Visite guidée lundi 8 mai, 17h00, fr
par les commissaires, sur inscription
Dialogue lundi 8 mai, 18h30, en
Agir avec l’incertitude
Ido Avissar (LIST) & Mio Tsuneyama (studio mnm)
Atelier pour enfants du mardi 11 au vendredi 14 avril
Cadavre exquis de la ville écologique
organisés avec Anna Pontais (SPS), sur inscription
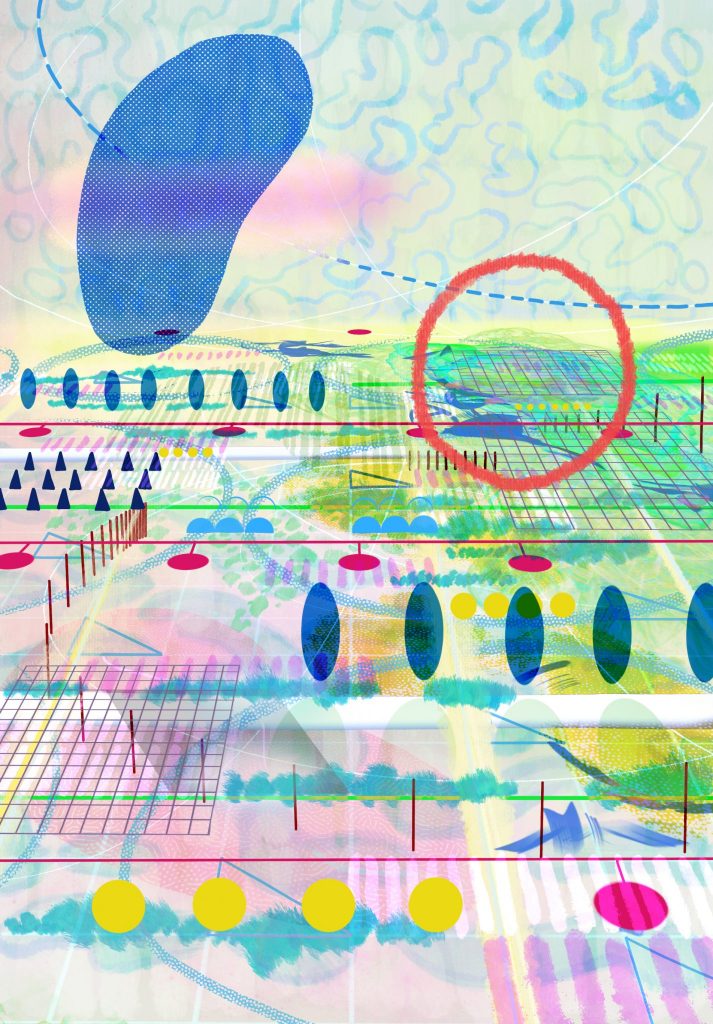
SYMPOÏÉTIQUE
Sympoïétique est formé par le grec ποίησις/poíēsis, « œuvre, création, fabrication » et le préfixe σύν/sún « avec », « ensemble ». La poíēsis se rapporte à l’étude des potentialités inscrites dans une situation donnée, augurant d’une création nouvelle. Au sens littéral, la sympoïétique est par conséquent un faire fusionnel, un faire avec ou ensemble. Un faire qui ne serait pas l’affirmation autonome d’une vision, mais la révélation de potentialités ou l’explicitation d’un existant non encore révélé.
INTRODUCTION
Les mutations que connaissent actuellement nos sociétés et nos environnements mettent en crise notre manière d’être au monde. Elles interrogent ainsi notre capacité à faire acte de projet ou, plus concrètement, à fabriquer des visions prospectives et à y ancrer des ambitions tangibles.
Ce contexte nous incite à imaginer de nouveaux agirs permettant de s’inscrire dans l’incertitude. Il faut dépasser l’effroi – ne pas laisser faire – et inventer des actions capables de s’inscrire dans le régime climatique qui vient.
Passer d’une logique des objets autonomes aux objets en relation ouvre de nouvelles perspectives sur les interfaces, les formes et les processus. Articulée autour de ces trois chapitres, l’exposition montre la manière dont la culture écologique peut colorer, informer et renouveler la culture du projet.
Marie Cazaban-Mazerolles et Julien Claparède-Petitpierre
Faire avec
Que s’est-il passé au juste sur Terre depuis un quart de millénaire?
L’Anthropocène.
L’Anthropo-quoi?
L’Anthropocène: nous y sommes déjà, alors autant apprivoiser ce mot barbare et ce dont il est le nom.
Ainsi débute l’essai que les historiens Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz ont consacré en 2016 à «l’événement Anthropocène». Ce mot barbare, comme ils disent, s’est depuis posé sur bien des lèvres, et malgré les critiques qui lui sont adressées, il semble bien qu’il se soit communément imposé pour nommer l’époque inquiète dans laquelle nous vivons. Marquée par des altérations conséquentes des systèmes biogéophysiques qui constituent notre environnement, cette nouvelle ère est aussi caractérisée par l’érection de l’humanité — anthropos — au rang de force géologique à part entière, dont l’empreinte se lit dans les couches stratigraphiques de notre planète. Dès 1990, le philosophe Michel Serres s’inquiétait de la signature laissée par cette humanité non pas dans le sol, mais à sa surface, sous la forme des grandes agglomérations — «plaques humaines immenses et denses» — désormais visibles depuis l’espace et comparables, du point de vue de leur influence sur le climat, à des formations aussi imposantes que les océans, les déserts ou les massifs montagneux. Trente ans plus tard, en 2020, nous apprenions que la masse anthropogénique, c’est-à-dire le poids de l’ensemble des objets et agrégats formés de main humaine et encore en service (sans compter, donc, les produits démolis ou jetés), dépassait désormais celui de la totalité de la biomasse, soit le poids de l’ensemble des organismes vivants, humains compris. Or plutôt que de célébrer ces nouvelles comme les preuves irréfutables de notre puissance et du triomphe de notre odyssée civilisatrice, c’est un nauséeux sentiment d’obscénité coupable qui nous étreint. Car cette extension maximale de notre domaine d’influence a un prix, dont le montant ne cesse, semble-t-il, d’augmenter: le système Terre se rebiffe, et alors que nous avons déjà rendu la planète invivable pour bien d’autres créatures, toujours plus de groupes humains subissent désormais la dégradation de leurs conditions matérielles d’existence. Quant au sort des générations futures, il est pour le moins marqué par les incertitudes. Dans ces conditions, l’expression proverbiale consistant à «apporter sa pierre à l’édifice» prend un arrière-goût amer. L’action humaine est désormais globalement sur la sellette; tandis que l’acte de construire et de fabriquer — coûteux en énergies fossiles, prédateur à l’égard des ressources naturelles et parfois écocidaire — se voit plus particulièrement frappé d’un soupçon difficile à balayer d’un simple revers de main. De ce point de vue, une forme de mauvaise conscience incapacitante n’est sans doute pas le moindre des problèmes qui se posent à l’architecte, urbaniste ou paysagiste un tant soit peu lucide quant au nouveau régime écologique dans lequel s’inscrivent sa vie et son travail. D’où le besoin d’imaginer et d’expérimenter de nouvelles façons de faire, permettant de résister à cette alternative impossible: renoncer à l’action, s’empêcher, s’abstenir — ou continuer comme avant, comme si de rien n’était.
Dans la culture occidentale, la première figure de «faiseur» dont nous héritons est celle du démiurge: divinité platonicienne créatrice d’univers, qui donne à la matière indéterminée la forme et l’ordre qu’elle
a préalablement imaginés. D’origine divine, le modèle démiurgique promeut un art de faire et de fabriquer compris comme acte d’imposer à un monde malléable sa puissance, ses désirs et ses intentions. Le démiurge, c’est Pygmalion sculptant Galatée; le Grand Ingénieur; l’Artiste, l’Artisan ou l’Architecte — mais toujours avec un grand A.
Or, longtemps célébré, ce personnage nous apparaît aujourd’hui boursouflé d’une arrogance illusoire et néfaste. Car le monde — la Terre — loin de pouvoir continuer à passer pour de la pure matière inerte manipulable à l’envi, sort de ses gonds et réplique. Selon la jolie formule de Serres, après la révolution copernicienne établissant que la Terre se meut, nous sommes aujourd’hui les témoins d’une seconde révolution: la Terre s’émeut. Elle réagit, et les créations que le démiurge a introduites dans le monde sont prises dans des devenirs qui échappent à sa maîtrise et à ses plans. Dans l’ombre du démiurge surgit une nouvelle figure: celle de l’apprenti sorcier. Dans le poème de Goethe qui donne naissance à ce personnage, un jeune magicien ensorcèle un balai qu’il charge de faire le ménage à sa place. Mais une fois que l’outil a achevé sa tâche, le jeune homme ne parvient plus à l’arrêter. L’apprenti sorcier, ainsi, incarne un humain dépassé par le pouvoir qu’il exerce sur le monde qui l’entoure et confronté à l’émancipation de ses œuvres. Or, si chez Goethe, le maître sorcier intervient pour ramener le balai affranchi à l’état de chose inerte, il est peu probable que quiconque soit en mesure de réduire la planète à la docilité: la Terre n’est pas un balai, et cette bête différence suffit à signer la défaite du faire démiurgique.
La figure du bricoleur, qui apparaît bien plus tardivement au sein de notre culture, propose un modèle alternatif. Selon ce dernier, le projet ne vient pas d’abord comme chez le démiurge, mais émerge dans un second temps de la matière déjà à disposition. Le bricoleur travaille à partir d’un répertoire composite de résidus d’œuvres antérieures, et ne connaît pas à l’avance le résultat de son ouvrage. L’anthropologue Claude Lévi-Strauss l’oppose ainsi à l’ingénieur (avatar démiurgique) qui impose depuis l’extérieur son projet à la nature, alors que le bricoleur, lui, agit toujours dans et depuis le monde: «La règle de son jeu, nous dit Lévi-Strauss, est de toujours s’arranger avec les ‹moyens du bord.» Si l’on en croit le biologiste François Jacob, l’incarnation par excellence de cet art du bricolage n’est pas une figure divine, mais le processus même de l’évolution naturelle: expérimentateur brouillon et persévérant, qui coupe ici et allonge là, «saisissant chaque opportunité de s’adapter progressivement à son nouvel usage». Se dessine ici une nouvelle façon de faire qui est une première forme de «faire avec»: un art d’accommoder les restes, de composer avec l’existant, de tenir compte de sa présence.
Mais «faire avec» peut avoir un autre sens encore, plus décisif peut-être. Celui d’un «faire à plusieurs», d’une collaboration entre plusieurs agent·x·e·s, plusieurs forces agissantes. Dans ce modèle, un monde autrefois réduit au statut de matériau ou de destination de l’action se voit reconnu comme acteur à son tour. Selon Catherine et Raphaël Larrère, qui associent cet art du «faire avec» à la figure du pilote, il s’agit moins dès lors de commander aux choses que de les infléchir: «On traite la nature en partenaire, on collabore avec elle […], on négocie, on ruse aussi parfois. Comme si l’on tendait à établir avec la nature et les êtres naturels que l’on manipule les rapports de sociabilité qui permettent aux hommes de vivre ensemble dans les communautés qu’ils forment.» S’ils impliquent de se défaire du fantasme de notre emprise absolue, ces arts de «faire avec» ne sont pas pour autant moins exigeants en savoir-faire ni en technologie, et ce serait une erreur d’y voir une forme maquillée d’attentisme ou de renoncement. S’ils sont anciens (sans eux, pas d’élevage ni d’agriculture), ils ne sont pas pour autant archaïques (en témoignent les techniques de modification génétiques comme la plupart des nanotechnologies, qui relèvent de leur paradigme). Et s’ils sont susceptibles de produire, eux aussi, des effets non intentionnels et potentiellement dommageables (comme dans la fable de l’apprenti sorcier), c’est en raison des limites des connaissances et compétences de qui les met en œuvre plutôt que par excès de pouvoir et indifférence au monde. Mais ce qui les distingue surtout, c’est le fait de concevoir l’action sous la forme d’un partenariat et, par conséquent, l’attention accordée à l’agentivité et aux spécificités du tissu biophysique avec le concours duquel — et non plus dans lequel — il s’agit désormais de fabriquer des mondes.
Dans son ouvrage intitulé Habiter en oiseau, la philosophe Vinciane Despret écrit qu’il n’y a aucune manière d’habiter qui ne soit d’abord avant tout de cohabiter. Peut-être est-il temps d’entériner encore qu’il n’y a aucune manière de construire et d’aménager qui ne soit d’abord avant tout de co-construire et co-aménager. Loin de la solitude divine du démiurge, il n’y a plus ici que des co-fabricant·x·e·s, incarnations nouvelles d’un art de faire conçu comme une «sympoïèse» qui se réalise, dans les mots d’Isabelle Stengers, «grâce aux autres et au risque des autres».
Faire projet
Parler de projet, c’est parler du temps, du temps de l’action. Or le temps est une drôle de chose si on y pense du point de vue de l’action. On doit à Peirce, le fondateur du pragmatisme américain, d’avoir ouvert ce dossier au début du XXe siècle et révélé ainsi l’hétérogénéité du temps.
Posons les choses: le passé renvoie à tout ce qui a eu lieu, tout ce qui a été fait et sur lequel on ne peut plus agir. On peut certes adopter face à lui des attitudes différentes — le rejeter, l’accepter, vouloir le corriger, l’oublier, le surmonter, s’en enorgueillir, le dissimuler — mais on ne le défait jamais. Le passé est têtu.
Le présent est quant à lui le temps de l’action, le moment où les possibles du futur basculent vers
les faits du passé. C’est le moment où le projet s’incarne, au risque de s’engluer dans la réalité et de perdre les flexibilités et légèretés des mondes futurs imaginés. Le présent est le lieu de la rencontre avec toutes les contraintes, avec toutes les résistances. Il est le lieu du test ultime. Souvent assimilé à un point évanescent, le présent n’est pourtant pas dénué d’épaisseur ni de lourdeur. Il est encore chargé du poids des projets passés qui ont atterri et vieillissent au présent, révélant leur efficacité ou leur incongruité. Le présent est habité par le passé: il est soutenu par les dispositifs bien établis qui continuent de le stabiliser, mais grevé aussi par des stigmates qui ne veulent pas disparaître et qui, parfois, telle une plaie infectée, ne cessent de s’aggraver. Si le passé est destiné à s’effacer dans des limbes immémoriaux, il reste longtemps présent, longtemps agissant. Vu depuis le présent, le passé est cette somme d’atouts, d’inerties et de contraintes qui s’attardent en circonscrivant le contexte d’action et de vie d’une époque. Dès lors, le présent n’est pas une page vierge, ouverte et libre. Pour autant, il n’est pas non plus déjà fait, fermé, figé par la colle du passé.
Le futur lui-même n’est pas une page blanche. Déjà réduit, corseté par les permanences du passé et par les exigences du présent, le futur reste pourtant le temps des possibles, au risque d’en perdre les contours. Car le possible, c’est ce qui n’est pas fait, ce qui n’est pas décidé; mais aussi ce qui peut accéder à la réalisation, ce qui peut rencontrer le réel et s’y inscrire. Ni effectif ni impossible, le possible n’est jamais certain. Néanmoins, le futur est également le temps des impossibles qui paraissent possibles. Il est le lieu des mondes utopiques et des terreurs dystopiques. Si le passé est rivé au présent
par l’obstination de traces qui tardent à disparaître; le futur, quant à lui, est ouvert par des imaginations promptes à errer. L’histoire des sciences et des techniques est, d’une certaine façon, le récit des méthodes mises au point pour se repérer dans cette étendue sans cadastre. Apprivoiser le futur, c’est apprendre la prospective, la vision en avant. Prévoir, prédire, simuler: tous les efforts sont consentis pour circonscrire les possibles, pour mesurer l’avenir. L’expérimentation méthodique a fondé la scientificité sur la réplicabilité: les mêmes conditions initiales produisent les mêmes résultats, les variables sont contrôlées, les résultats prédessinés, attendus, maîtrisables et maîtrisés.
C’est que le futur est chose dangereuse. Quand Edward Bernays — fondateur des «public relations» américaines et père des techniques de propagande — est chargé de promouvoir l’exposition universelle de New York en 1939, il organise toute sa communication sur la représentation d’un futur radieux accessible grâce au développement de la société de consommation. Sa campagne présente le monde idéal de demain, celui d’une démocratie libre, prospère, épanouie dans l’abondance des biens et des droits. Cet idéal, décrit à grand renfort d’images, de discours et de films, est présenté comme l’horizon vers lequel mènerait irrépressiblement un certain progrès technique porté par un système capitaliste au-dessus de tout soupçon. La technique de Bernays ici: invisibiliser les inquiétudes du présent en parlant du futur. Car le futur, pour peu qu’on veuille y croire, est le lieu des rêves non empêchés, des réalisations sans contraintes, de la démultiplication d’irréalisables possibles, des engagements sans responsabilités. Mais les rêves déçus laissent des traces et la confrontation retrouvée aux inerties du passé, aux rigueurs du présent et aux limites du futur peut inverser brutalement la donne. L’espoir naïf se meut en désespoir face à un monde incorrigiblement décevant.
La crise écologique actuelle a brutalement aggravé cette oscillation de nos affects. La crise qui se dessine est radicale, existentielle et, semble-t-il, incontrôlable. Car la crise écologique n’est pas seulement une crise de la foi, une crise de l’idéal du progrès économique infini promis par la représentation d’un monde de ressources inépuisables infiniment résilient.
La crise écologique est également une crise de la rationalité. La mise en lumière des phénomènes systémiques de complexité et d’émergence a déçu l’ancien espoir scientifique d’une prévision totale et d’une maîtrise absolue. En inventant la figure d’un «démon» omniscient, Laplace — mathématicien français de la fin du XVIIIe siècle — espérait abolir le temps par la sommation du savoir. La fable fonctionne ainsi: le démon connaît intégralement l’état de l’Univers à un moment T. De cette connaissance, il déduit immédiatement l’intégralité du passé et du futur. Réduits au rang de chaînes causales nécessaires, les événements passés et futurs s’enchaînent en une succession inexorable, si inexorable qu’aux yeux du démon — ou de Dieu —, elles sont arrêtées dans un éternel présent. Si tout, intégralement, était prévisible depuis le premier moment de l’Univers, le temps serait aboli. Ni passé, ni présent, ni futur: tout s’étalerait immuablement devant les yeux de la Science triomphante et omnisciente.
Dans les faits, le futur ne se laisse pas prévoir aussi facilement. L’expérience des concepteur·x·rice·s de la Philharmonie de Paris en témoigne. Les échecs antérieurs de modélisation acoustique les ont incité·x·e·s à dépasser les limites de la perfection informatique des ingénieur·x·e·s acousticien·x·ne·s pour élaborer leur projet qui a été construit en maquette, en petit, mais en vrai. Le test au présent, effectif, a ainsi révélé des effets non désirés, des scories imprévues, car imprévisibles. Il a fallu construire une maquette au 1/10, la remplir de petites figurines de mousse et placer le tout dans un caisson hyperbare permettant de ralentir le son pour savoir si l’acoustique allait fonctionner. Elle ne fonctionnait pas. Pas sans quelques retouches en tout cas. Malgré les progrès fabuleux des sciences physiques et des systèmes de traitement des données, le futur a retrouvé son mystère. Dans le cas des phénomènes acoustiques comme dans celui des phénomènes écosystémiques, le futur est farceur. Les phénomènes d’émergence dessinent un feuilletage de niveaux connectés, mais non déductibles les uns des autres. Le moindre élément peut modifier drastiquement le tout sans que l’on puisse savoir comment. Cette imprévisibilité des incidences est renforcée par la prolifération infinie des données.
Les travaux sur les espèces «clefs de voûte» en biologie ont montré que la chasse et la disparition des baleines dans l’océan Indien pouvaient détruire les écosystèmes des baies de l’Alaska: sans baleineaux à chasser, les orques remontent au nord et s’en prennent aux loutres d’Alaska. Sans loutres, les oursins ne sont plus chassés et prolifèrent. Ils dévorent les forêts d’algues qui tapissent les fonds des baies et abritent une riche biodiversité. Les forêts sous-marines dévorées, il ne reste plus rien. Les roches nues n’hébergent plus aucune forme de vie: les oursins eux-mêmes ont fini par périr. Le désert s’est installé et l’effondrement a eu lieu. Un effondrement partiel, certes, à l’échelle de la planète, mais un effondrement qui ressemble dangereusement à une maquette, à un essai à taille réduite de l’autre effondrement, le grand.
Pourtant l’effondrement lui-même n’est pas sûr et ne doit pas être vécu sous forme d’un futur incapacitant. Agir est toujours possible, toujours nécessaire, parfois urgent malgré les injonctions à la prudence et à la retenue qui légitimement nous assaillent. La simplicité des projets postulant des temps intégralement prévisibles, un progrès résolument linéaire et des modalités indéfiniment répétables de l’action doit néanmoins être évitée. La multiplicité des approches, des échelles, des méthodes et des attentions doit désormais nous inviter à prendre en compte la richesse du monde et ses indéfinies fécondités. C’est tout le cortège bigarré des actants de la planète qu’il nous faut désormais essayer de convoquer dans ces parlements multiactanciels qu’évoquait Bruno Latour. Les acousticien·x·ne·s, les physicien·x·ne·s atomiques, les baleines, les oursins, les écosystèmes d’Alaska, la couche d’ozone et les gisements fossiles ont des voix à faire valoir: elles nous parlent de leurs échelles, de leurs causalités, de leurs intrications systémiques inattendues et de futurs émergents, imprévisibles sans la minutie et
la multimodalité des enquêtes variées. Penser le projet aujourd’hui, c’est se représenter le concert des spécialistes prompt·x·e·s à s’écouter, prêt·x·e·s à agir, prudent·x·e·s dans leurs prédictions, à l’écoute des tests du réel.
Références
Edward Bernays, Propaganda (1928); Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, L’événement Anthropocène (2016); Vinciane Despret, Habiter en oiseau (2019); Johann Wolfgang von Goethe, «L’apprenti sorcier» (1797); François Jacob, «Evolution and Tinkering» (1977); Pierre-Simon Laplace, Essai philosophique sur les probabilités (1814); Catherine Larrère et Raphaël Larrère, Penser et agir avec la nature. Une enquête philosophique (2015); Bruno Latour, Politiques de la nature (1999) et Face à Gaïa. Huit conférences sur le nouveau régime climatique (2015); Jimmy Leipold, Propaganda. La Fabrique du consentement (2017); Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage (1962); Robert R. Payne, «Food Sec Complexity and Species Diversity» (1966); Charles Sanders Peirce, «Issues of pragmaticism» (1905); Platon, Timée (Ve siècle av. J.-C.); Michel Serres, Le contrat naturel (1990); Isabelle Stengers, Résister au désastre (2019).
51N4E, Aequipe, AGUR-Dunkerque, Atelier Descombes Rampini, Atelier Fanelsa, B+ Arno Brandlhuber, Simon Boudvin, CENTRAL office for architecture and urbanism, Cookies, Wim Cuyvers, Sophie Dars, Antoine Devaux, Francis Jonckheere, Claudy, Jongstra, Kosmos architects, l’AUC, LIST, MBL architectes, Comte Meuwly, Louise Morin, Fuminori Nosaku, Office for Political Innovation, Ooze, Plant en Houtgoed, Pedro Prazeres, rebuiLT, Christopher Roth, Studio Céline Baumann, Jo Taillieu architecten, Ten studio, Mio Tsuneyama, V+, Philippe Vander Maren, Richard Venlet
« 2100 Nouvelles alliances de la métropole »
Maquette produite par UR, Peaks, Altitude 35 – avec les contributions de ZEFCO, Marie Cazaban-Mazerolles et Julien Claparède-Petitpierre et les photographies d’Antoine Espinasseau pour l’exposition Augures, commissionnée par Djamel Klouche, BAP! 2019
Photographies : Antoine Espinasseau
L’équipe Archizoom
Direction
Cyril Veillon
Commissariat
Roxane Le Grelle
Coordination de Projet
Solène Hoffmann
Administration
Beatrice Raball
UR Architecture – Urbanisme
Gaétan Brunet
Chloé Valadié
Collaborateur·ice·s
Mathis Cividini
Alice Loumeau
Elsa Saunier
Remerciements
Marie Cazaban-Mazerolles
Julien Claparède-Petitpierre
Thierry Decuypere
Maxime Delvaux
Gabriele Manoli
Sébastien Marot
Luca Pattaroni
Paola Vigano
Parc Naturel Régional de Millevaches
Atelier des maquettes de l’EPFL
Textes
UR – Gaétan Brunet, Chloé Valadié
Marie Cazaban-Mazerolles
Julien Claparède-Petitpierre
Graphisme
Atelier Dyakova
Sophie Wietlisbach
Montage
Antoine Angeard
Esther Chatelain
Basil Ferrand
Nour Keller
Manuel Rossi
Arno Wüst









